Avant ma formation et mes démarches pour en comprendre le sens, j’étais capable de généraliser la notion mais incapable de l’exprimer clairement. Le bien-être est source de plaisir et de satisfaction. Dans ce cas, je peux ressentir un état agréable, de l’euphorie si c’est un synonyme, par bien des actions! Ma formation et mes recherches m’ont aidé à distinguer l’état et la satisfaction générée par des actes souvent mal estimés; les actes réalisés par mimétisme ou par automatisme se révèlent parfois néfastes pour la santé et le bien-être à terme (les addictions, l’impulsivité émotionnelle en sont les manifestations les plus évidentes).
Les satisfactions immédiates m’ont paru tout au long de mon cursus assez discutables y compris dans le temps que je dépense dans les distractions alors que j’ai des tâches à me libérer ou des souhaits à réaliser. Sans le décider au départ, j’ai commencé à changer des réactions, des attitudes et j’ai perçu par moment cet état quotidien et durable, à la mettre en pratique jusqu’à la recherche des définitions qui me paraissent très révélatrices de ce grand bien-être. Cela a renforcé mon savoir à propos du bien-être, ma pratique et mon vécu m’ont permis de le connaître un peu plus. J’ai encore tendance à confondre les actions: Il m’arrive encore de me répéter la définition que j’ai pu lire dans le Lexis du Larousse: « une sensation agréable que produit la pleine satisfaction des besoins physiques ». Difficile parfois de sortir de la confusion entre besoins, envie, plaisirs, distractions et désir… Des notions que l’on peut aborder plus tard. L’idée est d’équilibrer, unifier la pensée, le ressenti, la parole, les besoins et l’existence. Comment percevoir le bien-être?
Il existe plusieurs définitions et contexte pour approcher la notion de bien-être:
Une définition reconnaît le calme de l’esprit. Le bien-être serait l’exemption de troubles et d’agitation. Le terme de « sophrologie » signifie art de vivre sereinement. La vie étant faite d’événements et d’imprévus, est-ce que cela reviendrait à se couper des expériences de la vie? De nos émotions?
La notion de bien-être entendue dans le cadre du développement personnel expose un bien-être créé par la satisfaction des plaisirs et une l’absence de peine.
Peut-on se soustraire aux peines et ainsi aux émotions négatives? Peut-on écarter des situations et n’en vivre que certaines parmi les plus agréables? Serait-ce en se soustrayant aux émotions pour ne plus avoir à les ressentir? Mais alors comment ressentir la sérénité? La conjugaison du positif uniquement ou plutôt la soustraction du tout négatif peut-elle être seulement réalisable?
Serait-elle enviable? Cet état ne marquerait-il pas la fin du mouvement? Ne provoquerait-il pas l’ennui, une forme de stagnation,? Ne conduirait il pas à une forme de dépression par manque de stimulations et d’exploration? Le stress en liant aux expériences est la manifestation de l’adaptation au changement en réponse à ses stimulations, nous étudierons avec de la pratique comment amortir ses symptômes afin de bénéficier de tous les effets en terme de maîtrise de soi et d’exploration de l’existence et la chance de la réaliser. Il est question pour cela de s’affranchir de croyances et de présupposés immédiats quant au bien et au mal qui figent toute expérience, de percer à jour les émotions porteuses de valeur pour écouter le message qu’elles délivrent. Nous reprendrons des idées du développement personnel après les avoir perçu et reconnu afin d’amortir leur résonance et vivre en confiance et en estime.
Le « bien-être » peut ainsi être entendu en sophrologie comme une attitude positive de confiance en soi qui suspend le jugement immédiat dans ce que l’expérience amène à vivre.
Bien-être, c’est déjà bien vivre et la vie se manifeste par un corps, donc:
La santé, essence du bien-être:
Le bien-être est un état sain que l’on désigne par le mot « santé ». J’ai choisi une définition de la santé communément partagé dans le monde qui est celle de l’OMS.
L’Organisation Mondiale de la Santé, qui est une institution spécialisée de l’O.N.U, l’a défini comme « un état de complet bien-être physique, mental et social indépendamment de maladie ou d’infirmité. On peut en effet vivre le bien être dans de telles situations. Pour en savoir plus, un exposé de F.Lenoir à propos du taux de bonheur fixe et la capacité pour chacun de l’augmenter par un travail d’acceptation, de compréhension et de résilience qui permet d’élever la capacité de bonheur et de satisfaction de la vie au-delà des facteurs génétiques, du caractère et de la sensibilité de départ.
Il y a donc un aspect physique et un aspect psychologique.
Nous habitons un corps avec lequel nous vivons à la manière d’une co-dépendance. Son état agit directement sur l’équilibre psychique. Il exprime un ressenti à partir de sensations agréables, ou désagréables qui fait émerger toute sorte d’émotions et de pensées venant modifier nos perceptions. C’est pourquoi le bien-être dépend de son écoute pour un bon fonctionnement de l’organisme et la satisfaction des besoins qui fait naître le plaisir.
Il y a un aspect social et psychologique du bien-être.
En comparant les troubles psychologiques et le mal-être, on peut définir l’origine du bien-être et ce qu’il implique: la capacité d’être autonome, de surmonter les tensions normales de la vie, de nouer des liens, de participer à un projet commun. Parce que tout cela conduit favorablement à la réalisation de soi et à prendre une place.
Une approche concerne le contexte qui nous rassemble aujourd’hui:
Le bien-être dans le travail qui est recherché en éliminant fatigue, stress, nuisances sonores, et en établissant la qualité des relations et un bon espace de travail.
Cette partie est intégrée à la sophrologie pour la prévention des risques psychosociaux.
Il y a donc, aussi un aspect relationnel intimement lié à la recherche de bien-être, qui concerne un rapport à soi et qui fonde le rapport à l’autre. Une même représentation avec qui l’on apprend à composer et à se rapprocher pour nouer des relations harmonieuses et qui fonde l’éthique personnelle dans le rapport à l’autre:
Le bien-être est un désir éthique:
Intégré à l’éthique, le bien-être peut se définir comme l’épanouissement de soi dans la vie communautaire. Cette notion s’affirme hors sphère du conflit naissant d’une prétention opposant la satisfaction d’un « appétit » oppressant au regard des normes de conduite et des valeurs morales qui guident la société. Le choc né de cette inadéquation d’un désir avilissant, souvent pulsionnel ou compulsif, peut être à l’origine d’une volonté de puissance pressant à le réaliser. Le but lorsqu’il est manqué se répercute dans le psychisme de l’individu sous forme par exemple d’un sentiment de frustration, d’insatisfaction et s’accompagne pour les plus lucides d’une désillusion, qui les réoriente sur le chemin du bien-être. Suivre le bien-être plutôt que la satisfaction immédiate des désirs préserverait de la déception puisque le désir serait par essence « insatisfaction ». Pourtant, le désir nous habitent. Il est mouvement et force de vie. Il est caché par sa grande diversité, autant que nous avons de parties à le recevoir et autant qu’il y a de moyens à le représenter. La perte d’illusion le rend moins mystérieux et opère un retour à la simplicité. Il devient évident et réalisable. Il s’agit alors de suivre son courant menant à la réalisation du bien-être et de soi. La connaissance de soi et de ses mécanismes accroît l’autorégulation et la chance de le réaliser.
Le bien-être est très proche de la « vie bonne » définie par l’éthique en philosophie.
Le bien-être est la réalisation de la vie humaine et l’éthique serait sa condition.
Ces notions expriment une même intention que l’homme civilisé porte dans ses actions pour exister en état et persévérer dans un sentiment continu de vivre heureux et libre.
L’éthique est le substrat (le fond, l’essence) des actes et état d’être au monde ; elle est l’idée praticable de la morale qui nous fait naître à la société et qui orientent nos aspirations profondes hors pulsion et volonté de pouvoir. Mal dirigés, ils peuvent conduire à l’étiquettage, à la maladresse et la cruauté. Cette dernière comme bon nombre d’émotions se forment avec une représentation mentale, comme par exemple, un sentiment d’injustice qui autorise et revendique un rapport de compensation et de dommage dont on souhaite se rétribuer. La morale, fondée sur l’empathie collective équilibre ainsi les forces individuelles en nous imprégnant d’une multitudes de normes confusionnant valeurs et désirs . Ainsi, du même coup, nous suivons l’illusion d’être coupé de notre désir et nous le dénonçons en le reportant sur l’autre. L’absence vécu du désir mute en désir de revendication du manque, révélant la perte de valeur de soi et de celui que l’on dénonce comme auteur de l’injustice. Collectivement, chacun se revendique porteur d’une valeur comme étant la forme la plus authentique, l’unique vérité créant un rapport de force permanent qui annihile tout espoir de communication et de réalisation. L’éthique est la prise de conscience de soi, du désir, de la voie de sa réalisation et des forces en mouvements dont chacune, porteuse d’antagonisme, est susceptible de faire vaciller notre humanité. L’aspirant au bien-être éthique prend plutôt de la distance en reconnaissant ses réactions parce qu’il ne s’agit pas de réciter pour s’en imprégner mais de la pratiquer personnellement . Si la morale est un cadre extérieur à l’individu pour établir un idéale commun à tous, l’éthique est la mise en pratique de l’individu qui l’a intégré. Sa mise en place nécessite de la délicatesse, de la sensibilité et de la tempérance déjà vis-à-vis de soi alors que le cadre morale rigide et strict aurait tendance à rendre insensible ou hypersensible à l’intolérance et à l’ignorance. Elle repose sur une absence de parti pris d’une valeur au mépris d’une autre et une reconnaissance que toute se résume ou converge à la bienveillance. Elle est de ce fait une reconnaissance de la singularité, de la subjectivité de chacun. L’éthique comme l’empathie qui est à l’origine de la morale devient semblable à une liberté de l’autre: une exigence envers soi et une générosité envers les autres, une forme de sacrifice rendant parfois hommage à l’écoute, une réceptivité à partir de laquelle je me représente le monde de l’autre et que j’affine pour conduire à réaliser désir et agapé: une reconnaissance réciproque sensible de l’autre comme une extension de soi qui forge cette manifestation éthique et spirituelle de l’amour.
La bonne vie est donc un art de vivre et de s’épanouir en s’appuyant sur des valeurs partagées et sur un silence intérieur qui préserve du jugement et de représentation que l’on pourrait projeter sur l’autre comme de soi-même. La pratique de l’éthique amène l’individu agissant à reconnaître son pouvoir d’action ce qui le conduit à l’autorégulation, l’autonomie, à en être le garant et le principal responsable.
Elle mène aussi à la reconnaissance des limites de notre pouvoir d’actions et de notre incomplétude parce que l’autonomie n’est pas indépendance. Notre désir est aussi reconnaissance de la rencontre. Le désir est aussi collectif. Les notions garantissent donc un cadre où l’individu s’épanouie à partir d’un comportement qui révèle une attention à soi et des autres. Une attitude de neutralité bienveillante qui résume toutes les valeurs portées par l’humanité mis à jour au fil de nos expériences ressenties et intégrées. Je me représente parfois l’être idéalement éthique comme un être vivant porté par le sentiment de prolonger chaque instant son désir dans un côte à côte. Une présence physique et contemplative propre au reflet lisse d’un miroir donnant les traits vivants à l’image de la satisfaction . Ou plus simplement, d’un corps qui exprime dans sa contenance un langage ouvert; nous apprendrons à communiquer avec lui et se positionner avec ouverture. Nous apprendrons à ressentir, reconnaître, canaliser, libérer des parties de nous et parvenir durablement, en intégrant les tensions, à un état d’unité, de paix porteur de plénitude et pouvoir l’exprimer simplement. L’acceptation, l’estime et l’affirmation de soi seront abordés un peu plus loin.
Pour conclure, la sérénité serait en sophrologie semblable à un ressenti que l’on peut percevoir après l’action, après la réalisation d’un objectif ou d’un souhait et que l’on rend présent à partir d’un état d’écoute et d’intégration. Un accueil auquel on se rend disponible pour percevoir un certain nombre de phénomènes, corporel, mental et émotionnel qui manifestent des mouvements intérieurs: des sensations de relâchement, d’énergie, de la clarté, un état d’harmonie, une douce et positive intensité émotionnelle rendant libre l’attention à tout ce l’on peut percevoir dans l’ici et le maintenant. On y apprend à développer ce ressenti et à perpétuer ce sentiment propice à un cycle vertueux dans lequel on se recharge, on se renouvelle et on accroît ce sentiment d’être et d’exister.
Dans ce cadre très général, la sophrologie offre une parenthèse agréable pour s’entraîner à installer le bien-être personnel et à l’ancrer au niveau situationnel et relationnel en mobilisant à partir du ressenti un ensemble de comportements et d’actions visant à atténuer les perceptions négatives, à dégager du positif et peut-être le partager.
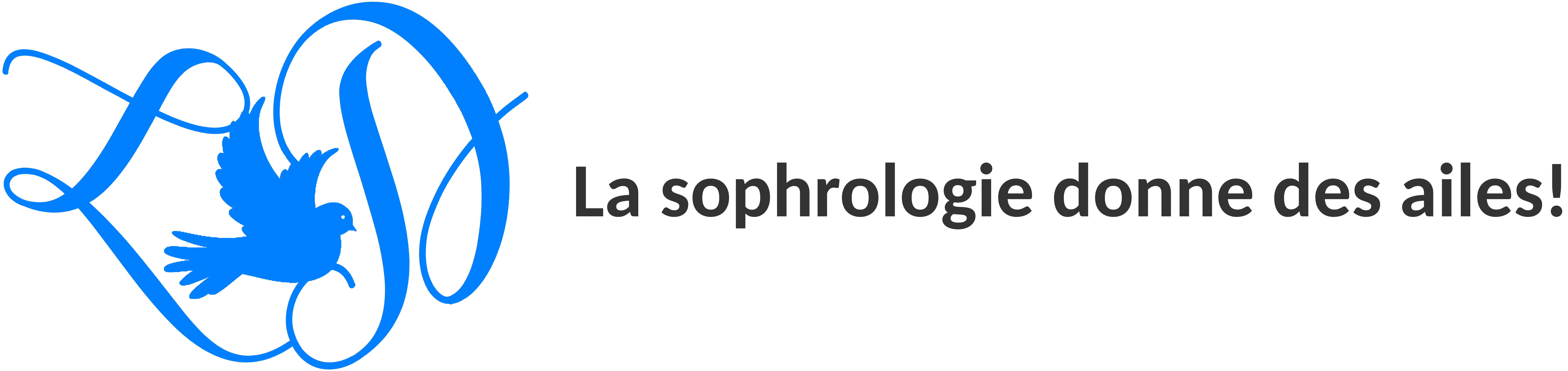
Leave A Comment